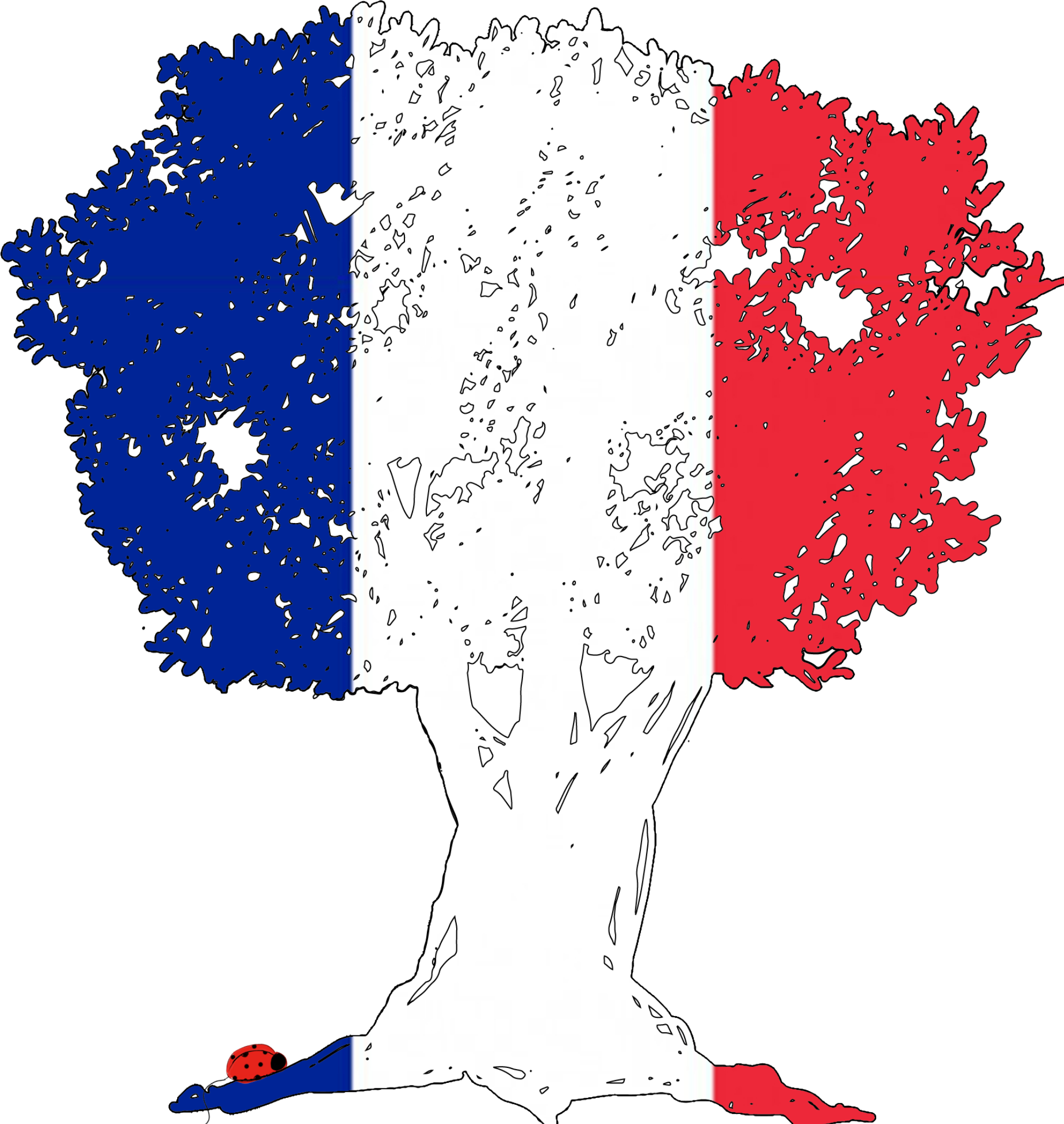Le général de Gaulle, de façon étonnante, dit un jour : « le terme d’indépendance nous est indifférent parce que, dans l’état actuel du monde, il ne signifie pas grand-chose, excepté pour la propagande. Aucun État n’est indépendant, car il est toujours, en réalité, plus ou moins lié à d’autres » (Jackson, p. 842). L’indépendance peut donc être considéré comme un slogan, voire comme un mythe. D’origine juridique, la notion désigne d’ailleurs une capacité de choisir qui appartient toujours à l’Etat français. Selon le conseil d’Etat, il n’y pas de perte de souveraineté française en ce sens (cf leur étude sur la souveraineté parue en 2024).
Cette définition de la souveraineté permet en réalité d’identifier les limites de la notion, qui ont trait à son manque de pertinence politique. Si la souveraineté se définit par la capacité à décider, alors se pose la question des décisions qu’elle doit permettre de prendre, de l’orientation politique qu’elle doit servir. La souveraineté interroge parce qu’elle fait référence à la capacité à décider, en laissant de côté la question « que décider » ? La question « que décider » fait moins référence à une capacité juridique (voire, économique, militaire, etc.) qu’à la vision de la politique qu’un exercice effectif de la souveraineté nécessite dans une société démocratique. Disposer de la capacité à décider repose en effet sur un édifice juridique qui n’est pas à terre (bien qu’il ait été fragilisé par de nombreuses décisions du conseil constitutionnel, de la CJUE, de la CEDH, etc.). En revanche, l’usage effectif de cette capacité nécessite des qualités personnelles, une capacité à « sentir le pays » et à prendre des décisions l’engageant tout entier, une capacité à discerner et une force d’âme qui est le vrai déficit que l’appel à la souveraineté cherche à combler.
Une telle qualité est d’autant plus rare en démocratie que les décisions prises engagent le pays tout entier. Les décisions souveraines doivent obtenir l’assentiment, sinon unanime, du moins majoritaire des citoyens français. Les contraintes nées de cette question du consentement ont largement pesé dans l’effritement de l’usage politique du pouvoir souverain. Celui-ci, au lieu d’assumer une forme d’arbitraire – ou, du moins, de contingence – qui est le propre du politique, a tendu à se cantonner à « l’exécution » de lois, forme impersonnelle d’autorité n’engageant pas la ou les personnes détentrices du pouvoir exécutif. Les démocraties libérales modernes ont ainsi favorisé l’éviction du politique au profit d’une lecture purement juridique du pouvoir. Dans le cadre de « l’Etat de Droit », la souveraineté se meurt moins des atteintes que lui porteraient des ennemis de la France que de l’incapacité des dirigeants à en faire usage.
Pour porter politiquement la souveraineté, il faut donc assumer un retour à une forme d’arbitraire du pouvoir, qui ne se contente pas d’exécuter des lois mais prend des décisions qui engagent le pays (et dont le droit peut d’ailleurs se faire un relais utile). La haine moderne de l’arbitraire exige de réhabiliter une telle conception du pouvoir.
En réalité – et l’histoire entière de la France atteste de ce fait – c’est lorsqu’il est exercé ainsi que le pouvoir exprime l’identité de la France. C’est cette forme arbitraire du pouvoir qui a permis à l’Etat de construire la France. Du baptême de Clovis à l’appel du 18 juin, en passant par Saint Louis et Napoléon, les dirigeants qui ont fait l’histoire de notre pays l’ont engagé dans des décisions qui matérialisaient, rendaient réels certains idéaux. Ils l’ont fait non pas en application du droit, mais parce qu’ils étaient eux-mêmes mus par ces idéaux. Ces derniers ont été pour eux un guide, une boussole intérieure qui les aidèrent à faire usage de la souveraineté (parfois, avant la formalisation conceptuelle de la notion).
Ces décisions n’ont d’ailleurs pas toujours suscité l’unanimité des Français. Cependant, parce qu’elles rendaient concrète des idéaux qui assumaient une forme de transcendance, elle donnait à la France et aux Français une place dans le monde. L’usage politique de la souveraineté, la décision politique au sens fort du terme, permet de donner un sens à la vie du pays et de son peuple.
Une telle façon d’exercer le pouvoir, puisqu’elle exprime l’identité de la France et donne ainsi un sens à son existence, rend possible le positionnement de chaque citoyen par rapport à ce sens. Bien loin d’une forme d’uniformité juridique, dans laquelle les comportements de tous sont prescrits par des normes aussi anonymes qu’universelles, la décision politique crée le cadre propice à l’expression de l’individualité de chacun. Cette individualité s’exprimera par un positionnement par rapport à ces idéaux que le dirigeant a pris sur lui d’exprimer – positionnement qui pourra aller jusqu’à l’anticonformisme, qui n’est pas, dans ce cadre, une transgression mais une originalité, un simple « point de vue » différent.
Un tel pouvoir peut sembler exorbitant. Il est pourtant au cœur de ce qu’est la politique, l’expression d’un collectif qui ne peut exister qu’à travers la confrontation des points de vue et donc, la rencontre et la relation des individus qui le forme – d’une communauté qui forge son unité dans la diversité.
Une telle lecture de la souveraineté, de l’expression de la volonté souveraine matérialisée par la décision d’un dirigeant, permet d’exprimer une forme de transcendance qui est la vocation de la politique dans son sens le plus noble. Le dirigeant capable d’en user ainsi ne peut d’ailleurs être un dictateur ou un autocrate, car il a besoin de ressentir au plus profond de lui l’identité de ce collectif qu’il exprimera à travers ses décisions. Il doit donc être capable de faire preuve d’une empathie, d’une capacité à entrer en relation avec les autres membres du collectif puis de définir, ou en tout cas d’exprimer, ce qui constitue son unité.