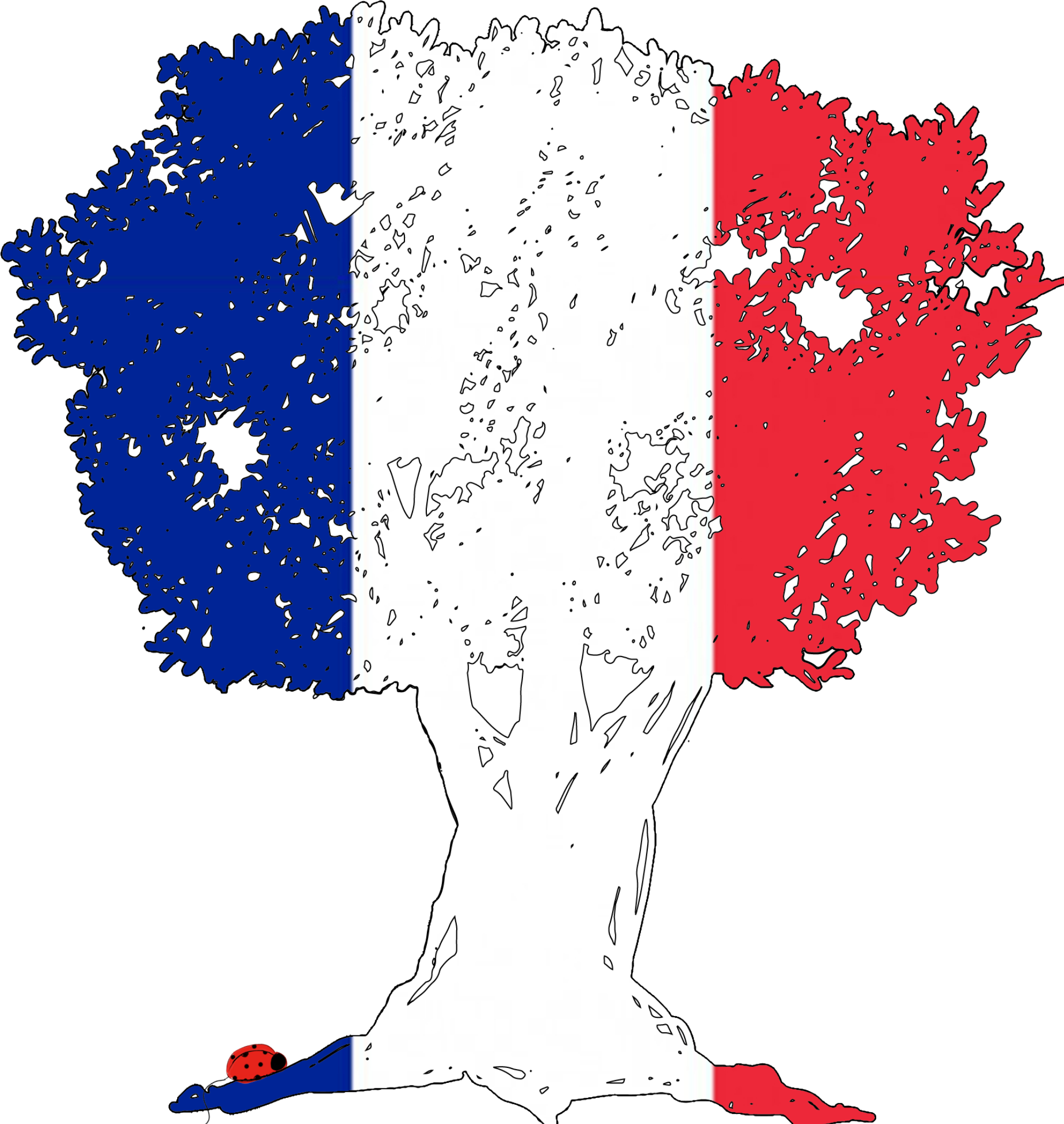La géopolitique, outre son intérêt intrinsèque, constitue un cadre idéal pour s’interroger sur la nature même de la politique. Plus précisément, elle permet d’interroger le rapport du politique au collectif qu’il régit, et constitue à ce titre un observatoire privilégié de la nature et des effets de la sécularisation propre à l’Occident. En effet, la pensée scientifique, rationnelle, fut déterminante dans la transformation de l’appareil d’État dans un contexte de guerre totale, dès la révolution, mais de façon plus caractéristique lors de la première1 puis de la seconde guerre mondiale2. On peut se demander si cette transformation, qui dépasse largement le cadre de l’armée, ne permet pas d’éclairer une évolution de celle-ci au XXème siècle, relevée par Philippe Vial :
La conception politico-technocratique de la défense, secteur parmi d’autres de l’action de l’État, l’a aujourd’hui emporté sur la vision politico-mystique, qui faisait de l’armée du temps de paix le double virtuel de la nation et son incarnation à l’heure des périls. L’épée n’est plus qu’un outil3.
Ainsi, la défense aurait été, en tant que projection politico-militaire de la « nation », victime de la transformation technocratique de l’État : l’armée, réduite à l’état d’ « outil », aurait perdu sa capacité à représenter, à incarner l’identité française au profit d’une « politico-technocratie » qui use de l’armée selon son besoin. Mais quel est ce besoin ?
Nous souhaitons nous demander ici si la réforme rationnelle de l’Etat n’a pas également transformé, avec l’armée, la façon dont nous abordons la guerre, et si cette évolution ne reflète pas une difficulté des sociétés sécularisées à s’approprier le sens de la politique. Pour mener à bien une telle réflexion, nous nous interrogerons sur ce que notre rapport à la guerre dit de notre rapport à la politique. Nous verrons que notre difficulté à nous en saisir peut s’expliquer par la subordination de la politique à un « ordre », à l’échelle nationale mais aussi, et peut-être surtout, à l’échelle internationale. La nature d’un tel ordre fait apparaître l’ambiguïté du statut du droit, réputé exprimer une autorité échappant à la volonté de l’homme, autorité qui vient de sa capacité à exprimer et faire respecter un « ordre » inscrit dans la nature. Nous conclurons en proposant de reconsidérer la nature de cet ordre à l’aune de la volonté humaine qui l’a institué.
- Guerre et politique
Dans une étude de l’American Way of War, le Général Yakovleff concluait que « le plus important enseignement de cette guerre du Golfe est donc que l’école de guerre américaine sait gagner des guerres, mais qu’elle ne sait pas transformer une victoire complète en prolégomènes d’une paix durable et équitable. L’expérience s’est répétée dans les Balkans, en Afghanistan, en Libye…4 »
Ainsi, le lien entre guerre et politique – l’aphorisme de Clausewitz selon lequel « la guerre, c’est la politique continuée par d’autres moyens » – semble distendu, voire rompu dans les systèmes politico-militaires occidentaux modernes. Cette évolution peut d’ailleurs contribuer à expliquer nos difficultés à définir, dans le conflit nous opposant indirectement, au soutien de l’Ukraine, à la Russie, des buts de guerre tangibles, au profit de discours souvent vagues sur la nécessité qu’il y aurait à obtenir une « victoire de l’Ukraine » ou une « défaite de la Russie ».
La guerre, si elle est la continuation de politique par d’autres moyens, n’en est pas moins un cas limite de l’expérience politique. Dans la guerre, la communauté politique se soude dans une identité renforcée par la confrontation avec une altérité. Le « nous » s’oppose à ce qui n’est pas lui. Elle peut ainsi être considéré comme un ciment communautaire et identitaire. Ce qu’on a pu appeler la « naissance de la nation Ukrainienne » suffit à illustrer ce propos.
Cependant, considérer la guerre uniquement sous cet aspect identitaire ne permet pas de saisir sa dimension proprement politique, c’est-à-dire relative à la vie d’une communauté donnée. Se définir en tant que communauté ne permet pas de définir des buts de guerre. Pour cela, il est nécessaire de mener une réflexion spécifiquement politique, inscrite dans la contingence de l’existence humaine. La stratégie, à cette aune, n’est que la définition des moyens d’atteindre ces buts de guerre.
Dans son Traité de l’Efficacité5, François Jullien compare la conception occidentale et la conception chinoise de l’action. Il insiste sur le fait que dans l’esprit chinois, l’homme d’action, le véritable stratège, est celui qui sait tirer profit des situations. Il analyse les situations et, sachant où se trouve son profit, en tire le meilleur parti possible. Une telle représentation de l’action s’oppose à la vision occidentale pour laquelle agir, c’est faire par un effort surhumain correspondre le monde à un modèle préconçu, un modèle théorique.
- Politique et ordre
Cette analyse de la conception occidentale de l’action est confortée par l’importance accordée par la théorie et la pratique du gouvernement en occident de la notion « d’ordre ». La politique est conçue comme l’inscription de la vie des sociétés dans un ordre, dont la portée peut être nationale ou international. Les institutions sont conçues comme les garantes d’un tel ordre, et le rôle des hommes est simplement d’administrer les institutions de telle sorte qu’elles assument ce rôle de garant de l’ordre.
Cette référence à l’ordre peut s’exprimer dans la responsabilité de l’État à l’intérieur d’une nation donnée. C’est bien entendu dans le domaine économique que le rôle de l’État se conçoit le plus clairement comme le garant d’un « ordre » ; il est tout aussi évident que cet « ordre » tire sa force normative de théories scientifiques. Il en est ainsi depuis l’invention de l’économie politique. Des chercheurs importants se sont attachés à démontrer la force normative d’un ordre économique défini scientifiquement pour l’action de l’État moderne6.
L’autre domaine dans lequel le rôle de l’État se conçoit par référence à un « ordre », c’est celui de la sécurité. Pour Michel Foucault, d’ailleurs, les dimensions économiques et sécuritaires allaient de pair dans l’émergence de l’État moderne. On peut citer ici Raymond Aron qui résume avec la force de l’évidence : « L’objectif premier de tout ordre politique, c’est de faire vivre les hommes en paix, d’éviter que la violence se déchaîne entre les citoyens. D’où nous tirons immédiatement ce que Max Weber tenait pour la définition même de l’État, à savoir le monopole de l’usage légitime de la violence. Pour que les hommes ne s’entre-tuent pas, il faut que l’État, et l’État seul, ait le droit d’employer la force »7.
Si l’on s’intéresse à la dimension internationale de cet ordre occidental, l’interdépendance entre sa dimension économique et sa dimension sécuritaire devient évidente. Les institutions garantes de l’ordre international attestent de ce double objectif sécuritaire et économique – au premier rang desquelles l’ONU, dont le préambule de sa charte, ainsi que ses deux principaux conseils (de sécurité d’une part, économique et social d’autre part) confirment nos propos.
Cette double dimension, sécuritaire et économique, est néanmoins subordonnée à une troisième, qui nous est si évidente qu’il nous est difficile de la percevoir : l’ordre national, comme l’ordre international, sont essentiellement des ordres juridiques. On découvre ce fondement juridique d’un ordre international tendu vers une paix à laquelle le commerce – en particulier le commerce international – contribue, en particulier chez Kant8.
- Droit et science
Or, la proposition Kantienne d’un ordre juridique tendu Vers la paix perpétuelle trouve sa racine dans une conception rationnelle, scientifique du droit. Le premier supplément à ce traité, qui stipule que « la nature garantit la paix perpétuelle par le mécanisme même des penchants naturels » montre bien que c’est dans la nature elle-même que le philosophe prétend tirer la légitimité de son projet.
Cette légitimité « scientifique » est également renforcé par le second supplément au traité de Kant, dans lequel le philosophe défend l’introduction dans les traités de droit public de l’article secret suivant : « Les maximes des philosophes sur les conditions qui rendent possible la paix publique doivent être prises en considération par les États armés pour la guerre ». Ainsi, bien que les États doivent demeurer les dépositaires du pouvoir, les philosophes, qui sont au fait des « conditions qui rendent possible la paix » (conditions tirées d’une connaissance d’un ordre inscrit dans la nature elle-même) doivent officieusement leur tenir lieu de conscience.
Autorité juridique et autorité scientifique sont donc également mêlées. « Si ces liens sont si étroits, c’est parce que le Droit a été, avec la science, le lieu d’invention d’une approche méthodique et rationnelle des situations d’incertitude. […] Cette parenté se retrouve aux origines de la science moderne, notamment dans l’œuvre de Francis Bacon, qui, aux débuts du XVIIème siècle, posa en même temps les bases de la méthode scientifique expérimentale […] et celles d’une méthode universelle d’élaboration du Droit »9.
Cette citation tiré d’une communication au collège de France d’Alain Supiot, nous permet de nous rendre compte que la convergence d’un ordre juridique et de normes scientifiques ne sont pas fortuites : « le Droit consacre l’autorité de la science et intègre ses acquis »10. Cette relation entre deux ordres de finalité différente « est lourde de dangers pour la vérité scientifique, ainsi toujours menacée de dogmatisation »11.
La référence est loin d’être fortuite : pour Alain Supiot, « le propre d’un ordre juridique […] est précisément de reposer sur un certain nombre de vérités légales […] qui procèdent d’une affirmation dogmatique et non d’une démonstration scientifique ». Cependant, il convient de tirer toutes les conséquences de cette distinction entre affirmation dogmatique et démonstration scientifique – car ce n’est pas son statut de vérité démontrée qui donne sa force au dogme, mais sa source, son émetteur.
- La place du politique
En réalité, la conservation d’un fondement dogmatique du droit chez Supiot semble contredire son analyse de sa création conjointe à celle de la science. Tous deux sont issus, on l’a dit, de la mise en œuvre d’une « approche méthodique et rationnelle des situations d’incertitudes ». Le paradoxe du droit moderne, qui tient à la fois de la construction rationnelle et du dogme, apparaît dans toute sa clarté, et explique la relation complexe de l’Occident à la politique, à la guerre, et plus généralement aux relations internationales. .
Cette complexité s’éclaire en confrontant les notions d’ordre et de relations internationales. Un ordre, en effet, fait référence à un cadre figé dans lequel la place, le rôle occupé par chaque acteur (chaque nation) est défini de façon fixe et, surtout, surplombante – le ou les garants de l’ordre se situent de facto « au-dessus » de ses membres. La notion de relations internationales, au contraire, fait référence à une situation vivante, mouvante, dans laquelle les rapports sont sans cesse sujets à évolution et à redéfinition. On pourrait plutôt parler, pour évoquer les relations internationales en général, du « concert des nations ».
En effet, le sens des relations internationales nous semble la recherche d’une compréhension mutuelle de peuples irréductiblement différents entre eux – du même que le sens des relations humaines est d’apprendre à découvrir les autres. Cette « découverte de l’autre » n’est pas une injonction à un altruiste qui serait un impératif catégorique. La rencontre ne vaut que parce qu’elle est l’occasion d’une meilleure connaissance de soi. A l’échelle internationale, le dialogue entre nations est l’occasion pour chacune de mieux identifier et mieux affirmer son identité, son unicité.
Les relations entre nations sont bien souvent déterminées – sinon dans leur qualité, du moins dans leur intensité – par leurs rapports historiques et géographiques. Tout comme dans la vie humaine, la relation ne peut exister qu’à travers des sujets concrets, qui sont autant d’occasions d’approfondir la relation. Mais à travers ces sujets concrets, c’est bien l’identité des nations qui transparaît ; c’est ainsi que les relations internationales sont aussi l’occasion d’une réflexion sur le phénomène dit de « sécularisation ».
- Administration et organisation 1910-1930 ; de l’organisation de la bataille à la bataille de l’organisation dans l’administration française – Stéphane Rials – Beauchesne – Librairie des Sciences-Politiques, Paris, 1997 ↩︎
- François-Xavier de Vaujany, Apocalypse managériale (Les Belles Lettres, 2022). ↩︎
- Philippe Vial, « De l’épée à l’outil : l’armée, communauté ou instrument ? », Inflexions 36, no 3 (2017): 73‑84, https://doi.org/10.3917/infle.036.0073. ↩︎
- Michel Yakovleff, « La guerre du Golfe et les écueils de l’American Way of War », Revue Défense Nationale 843, no 8 (2021): 17‑25, https://doi.org/10.3917/rdna.843.0017. ↩︎
- François Jullien, Traité de l’efficacité (Paris: Grasset, 1996). ↩︎
- Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, Seuil, Hautes Etudes (Gallimard, 1979); Karl Polanyi, La Grande Transformation, Gallimard, Tel (Gallimard, 2009). ↩︎
- Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme (Editions Gallimard, 2017). ↩︎
- Vers la paix perpétuelle Un projet philosophique | Collection Textes & Commentaires, 2007, https://www.vrin.fr/livre/9782711619191/vers-la-paix-perpetuelle-un-projet-philosophique. ↩︎
- Alain Supiot, « L’autorité de la science. Vérité scientifique et vérité légale », in Science et démocratie, Colloque annuel du Collège de France (Paris: Odile Jacob, 2014), 81‑109, https://doi.org/10.3917/oj.haroc.2014.01.0081. ↩︎
- Supiot. ↩︎
- Supiot. ↩︎